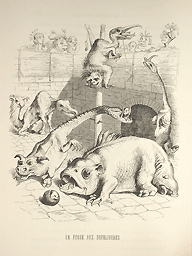Métamorphoses des « métamorphoses » de Grandville
La comparaison et/ou l’opposition des formes, des caractères et des passions des hommes et des animaux, thème récurrent de la réflexion métaphysique et morale, de la recherche scientifique comme de la philosophie populaire, s’est vue renouvelée dans la première moitié du XIXe siècle en France, sous ces différentes facettes, par l’actualité culturelle et artistique. Différentes traductions des Physiognomische Fragmente du pasteur suisse Johann-Caspar Lavater (1741-1801) ont remis au goût du jour les spéculations pseudo-scientifiques de la physiognomonie, qui prétendait décrypter le caractère des individus en fonction de leur ressemblance avec les animaux ; la théorie « des analogues » d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), largement diffusée sur la place publique par les querelles qu’elle suscitait dans les milieux scientifiques, a répandu l’idée de l’unité de composition du monde organisé, affirmant que tous les organismes descendent d’une espèce primitive unique. À l’origine de l’idée première de la Comédie humaine, comme le soulignait Balzac dans son célèbre Avant-propos, la comparaison entre humanité et animalité fut aussi au fondement de l’œuvre graphique du plus grand illustrateur et caricaturiste de cette époque, J.J. Grandville (1803-1847) : ses « métamorphoses », fondées sur l’hybridation de l’homme et de l’animal, renouvelèrent les formes et les messages traditionnels de la caricature en conjuguant les héritages de la satire sociale et politique et les apports culturels et scientifiques de l’époque.
Je m’intéresserai ici à l’émergence et aux évolutions, au sein de la création prolifique et polymorphe de Grandville, de cette formule satirique, élaborée dans le cadre de la caricature de mœurs au début des années 1820, en examinant plus précisément ses variations et ses mutations en fonction des stratégies professionnelles de l’illustrateur, de ses rencontres et de ses confrontations avec des textes d’écrivains, des projets d’éditeurs, des supports nouveaux de diffusion. Comment ce dispositif caricatural populaire a-t-il été diversifié, nuancé, infléchi par Grandville au fil de sa carrière, illustrant un classique de la littérature française, les Fables de La Fontaine, en 1837, inspirant un collectif d’écrivains dans les Scènes de la vie privée et publique des Animaux en 1840-1842, ou servant les ambitions majeures de l’artiste dans Un Autre monde en 1843 ? À travers les variations de cet archétype iconographique, ce sont, plus largement, les conditions et les modalités de la création graphique dans l’édition romantique que je souhaite ici éclairer, en mettant l’accent sur les déterminations de tous ordres – culturelles, littéraires, éditoriales et sociologiques – qui ont alors déterminé, entravé ou stimulé l’inspiration de cet artiste.
La « métamorphose » comme dispositif caricatural
|
Les premières expérimentations de Grandville apparaissent dans des dessins réalisés en 1820, qui parodient orchestres et musiciens locaux (fig. 1). Le futur artiste n’invente pas le thème satirique millénaire des animaux musiciens, dont les premiers témoignages se rencontrent dans des papyrus égyptiens (2), mais il expérimente ici pour la première fois deux formules caricaturales d’hybridation des espèces animale et humaine dont il déclinera par la suite de nombreuses variantes : humanisation de l’animal, dressé sur deux pattes, doté de vêtements et d’accessoires humains mais conservant des membres postérieurs zoomorphes ; animalisation de l’homme, dont le corps entièrement humain se voit surmonté d’une tête de bête. C’est par ces procédés de métissage et leur conjugaison dans un même dessin – qui brouille la perception de l’hétérogénéité de ces entités –, par l’attention technique portée à la greffe de ces éléments étrangers, dans le but de créer l’illusion, que Grandville jette la confusion entre les espèces, affirmant d’emblée – il n’a que dix-sept ans – son originalité vis à vis des caricaturistes de son temps, lesquels privilégient une formule unique : des visages humains greffés, sans souci de « réalisme », sur des corps d’animaux. Dans ce dessin, Grandville attribue à chaque animal musicien un instrument dont le son s’apparente à son cri : le canard joue de la clarinette, le bœuf du basson. Dans deux autres dessins de la même époque, construits sur cette même analogie sonore – un canard clarinettiste et un bœuf bassoniste – Grandville complique ses compositions d’analogies linguistiques fondées sur la traduction plastique d’expressions de la langue française : « faire un canard (ou un « couac »), « souffler comme un bœuf ». Cette transmutation en images d’expressions, de dictons et de locutions françaises, significative d’un art où l’élément plastique procède de l’idée, constitue un procédé que l’artiste exploitera abondamment tout au long de sa carrière, depuis ses Principes de grammaire (Senefelder, ca 1830) jusqu’aux Cent Proverbes (Fournier, 1845), s’attirant le reproche de Baudelaire : « Grandville est un esprit maladivement littéraire, toujours en quête de moyens bâtards pour faire entrer sa pensée dans le domaine des arts plastiques » (3).
|
Ces dispositifs satiriques, élaborés dès les années d’apprentissage du jeune artiste, assurent le succès des Métamorphoses du jour, suite de soixante et onze lithographies publiées d’abord isolément chez Bulla de 1828 à 1829, puis réunies en recueil sous une couverture illustrée (4). Le propos est ici plus incisif et plus large que dans les premier dessins : il s’agit de dénoncer l’animalité de la nature humaine dans l’universalité de ses instincts primaires (penchants alimentaires et sexuels), dans la diversité de ses manifestations sociales et politiques, dans la particularité de ses incarnations individuelles. Le projet satirique et moraliste de Grandville s’affiche sur la couverture du recueil, qui figure une séance de lanterne magique, divertissement alors à la mode dans les familles : un aristocrate ventripotent est assis, le haut du corps caché derrière un écran ; la lanterne projette à la hauteur de son visage trois têtes d’animaux, le bouc, le loup et le lion qui, suivant les théories physiognomoniques, incarnent les instincts liés à leur nature : la luxure, la gourmandise et la colère. L’écran sur lequel s’effectue cette opération joue de sa double fonction : il masque le visage de l’individu et il révèle la face cachée du personnage. La métaphore de la lanterne magique est ici doublement significative : elle donne à voir le travail du dessinateur, qui greffe des visages de bêtes sur des corps humains ; elle illustre la démarche du caricaturiste qui, à la façon du projectionniste, met en lumière la nature double de l’homme en même temps qu’il éclaire la lanterne de son public. Envisagé sous cet angle, le projet de Grandville se démarque des légèretés de son époque ; comme dans Le Voyage pour l’éternité (Bulla, 1830), dont Balzac apprécie la « profondeur philosophique», la lanterne de Grandville n’a pas le rire pour objectif mais seulement pour moyen : elle invite à la réflexion.
Dans le recueil des Métamorphoses du jour, auquel Grandville doit sa célébrité, l’artiste utilise une formule caricaturale unique, qu’il nomme « métamorphose » : des têtes d’animaux greffées sur des corps humains (humains animalisés). Le choix de l’animal susceptible de traduire avec bonheur la face cachée de la réalité humaine se fonde sur différents critères : la ressemblance physique (un bourgeois bedonnant représenté en éléphant, un grande jeune fille en girafe, etc.) ; la ressemblance morale (supposée) entre l’homme et l’animal, suivant des critères établis depuis des siècles par les traités de physiognomonie ; la métaphore verbale, qui désigne cette réalité dans le langage familier, vulgaire ou argotique : un « ours », un « cochon », une « vipère », une « tigresse », etc. L’époque a mis ces jeux de langage à la mode : la langue française peuple Paris d’un bestiaire, où se croisent les « lions » (« jeune homme qui se met au pied des bottes vernies d’une valeur de trente francs », suivant la définition de Balzac (5)), les « merlans » (coiffeurs), les « pigeons » (acheteurs), les « lézards » (flâneurs), les « crocodiles » (pique-assiettes), les petits « rats » (danseuses), etc. La tradition littéraire intervient également dans le choix de l’animal, celle de la fable en particulier, mais aussi celle du conte et de la légende, comme le laisse entendre le titre du recueil, Métamorphoses du jour, qui fait implicitement référence à ses prédécesseurs, grecs et latins. Enfin, les héritages picturaux imposent aussi leurs archétypes, comme le motif ancestral du singe-peintre, remis à la mode par Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1789) au XVIIIe siècle, ou celui de l'âne maître d'école (fig. 2), présent dans la caricature et la littérature grecques et chez les poètes latins Ovide et Apulée. Mais à la différence des poètes, l’objectif du dessinateur est de créer une illusion visuelle. Grandville y parvient par une pratique originale de la lithographie, qui dédaigne le modelé et le moelleux du crayon gras lithographique, alors prisé par les spécialistes du paysage romantique (6), au profit de la plume, qui matérialise sur la pierre le coup de griffe du caricaturiste et qui confère à l'épreuve imprimée la force incisive de la gravure au burin. Ses dessins d’animaux, réalistes, précis, parfaitement identifiables, contribuent à rendre crédibles ses improbables créatures de papier. La mise en scène des personnages, que Grandville rassemble dans une action et un dialogue communs, parfait l'illusion. L’ensemble produit un effet de réalité saisissant : s’agit-il d’hommes à têtes de bêtes ou d’animaux parlants ? La fusion des deux règnes est totale.
Métamorphoses littéraires
|
Les talents d’animalier de Grandville conduisent l'éditeur Henri Fournier à lui proposer en 1837 d’illustrer une nouvelle édition des Fables de La Fontaine (7). Cette entreprise s’inscrit dans le renouveau du livre illustré qui s’opère en France à cette époque : un certain nombre d’éditeurs, particulièrement dynamiques, ont conscience que la société bourgeoise de la Monarchie de Juillet leur offre un public de nouveaux lecteurs, dont l’accès à l’écrit passe par l’agrément des images, et que le moment est venu de lui offrir des produits éditoriaux répondant à ses goûts. Ces projets sont favorisés par la gravure sur bois de bout, qui permet de reproduire les dessins originaux avec une grande finesse et, à la différence des procédés utilisés jusqu’alors, de les combiner à la typographie. Grandville, qui s’est essentiellement consacré à la caricature politique dans la presse républicaine depuis 1830, s’est tourné vers l’illustration en 1836 après l’interdiction des caricatures politiques par Louis-Philippe en septembre 1835, accusées d’avoir moralement armé les terroristes qui ont tenté de l’assassiner en juillet. Ces lois, qui privent l’artiste de ses revenus, lui offrent en fait l’opportunité d’une promotion professionnelle. La statut de « roi de la caricature », dont Grandville était gratifié, était en effet loin d’être glorieux, le situant tout au bas de la hiérarchie artistique, ainsi qu’en témoigne son ami Edouard Charton, directeur du Magasin pittoresque qui évoque l’artiste à l’époque des Métamorphoses :
« Je rencontrai Grandville pour la première fois dans un atelier d'architecte où se réunissaient chaque jour en hiver les jeunes artistes. Seul entre les habitués, il avait déjà une réputation. Les Métamorphoses, son chef-d'œuvre, l'avaient mis au premier rang des dessinateurs satiriques. Je remarquai son air de modeste défiance et fus plus étonné de voir que la réunion ne paraissait pas tenir en grande estime son talent et son succès. Les élèves en peinture y dominaient ; ils se préparaient au concours de l'école et avaient pour perspective le prix de Rome. Ils aspiraient à continuer Gérard, Gros, Girodet. Ils rêvaient la poésie et la gloire. Pour eux, Grandville prenait place, dès son début, à un degré inférieur de l'art et, paraissant résolu à s'y tenir, s'était volontairement limité, amoindri ; on était presque tenté de le plaindre. C'était un homme classé, fini, un caricaturiste. »
L’illustration des Fables de La Fontaine offre à Grandville l’occasion de valoriser ses talents : on considère en effet au XIXe siècle que, par un phénomène d'osmose, la distinction d’une œuvre littéraire est transmise à son illustrateur. Charles Blanc, par exemple, conseille à Grandville d’illustrer Molière en ces termes : « Voilà l'homme dont il faudrait illustrer les œuvres, car les illustrer c'était en comprendre toute la grandeur, c'est-à-dire passer soi-même au rang des maîtres. » Aussi, quand l'éditeur Fournier s’adresse à l’artiste pour illustrer La Fontaine, Grandville s'avoue tout à la fois flatté et effrayé par l’entreprise :
« Cette tâche m'épouvanta, m'interdit […] envisageant l'extrême difficulté de cette entreprise audacieuse à coller des dessins à l'œuvre admirable du si grand et si fin fablier, du bon et supérieurissime la Fontaine, moi ! »
La contrepartie de cet honneur est triple : en tant qu’illustrateur, il est appelé à traduire la pensée d’un autre, et il perd la possibilité d’exercer librement ses talents ; le support livresque lui impose désormais ses cadres et ses traditions ; enfin, il doit se plier à la technique du bois de bout, dont il n’a pas encore grande expérience, et qui exige l’intervention d’un graveur spécialisé, le privant de la maîtrise complète de son art.
Comment Grandville adapte-t-il dans ce nouveau contexte son système personnel de caricature pour le mettre au service d’un genre littéraire consacré –la fable– et d’un auteur classique qui est lui-même un virtuose de la métaphore animale ? Comment fait-il passer ses animaux comiques d’un support populaire – l’estampe lithographique en couleurs – à un vecteur culturel plus noble mais plus contraignant ? Comment donne-t-il corps – ou plus exactement quel corps donne-t-il – aux acteurs de la fable, qui joue précisément de l’ambiguïté entre nature humaine et nature animale ? Les premiers illustrateurs de La Fontaine avaient représenté les animaux sous une forme naturelle : ce fut le choix de François Chauveau dans la première édition des Fables (Barbin, 1668), et de Jean-Baptiste Oudry au siècle suivant (Charles-Antoine Jombert, 1755). Au début du XIXe siècle, les illustrateurs, qui voyaient surtout en La Fontaine un moraliste, ont privilégié, quant à eux, les figures humaines (Percier, 1802 ; Moreau le jeune, 1808 ; Desenne, 1817 ; Bergeret, 1818). Grandville n’adopte aucun parti systématique, considère le cas de chaque fable en particulier, procédant par réflexion et tâtonnements, comme il l’a relaté dans un manuscrit qui accompagne ses dessins préparatoires, conservé aujourd’hui à la Bibliothèque municipale de Nancy, sa ville natale. Ce qui frappe, c’est l’extrême diversité des solutions adoptées : des traductions animales, des interprétations humaines, des hybrides, des végétaux et objets animés.
Le groupe des traductions animales, qui nous intéresse ici plus particulièrement, est quantitativement le plus important et décline un riche éventail de variations sur les deux formules d’hybridation inaugurées dans sa jeunesse, qui lui permet de s’adapter avec souplesse et sans dogmatisme au propos, non moins varié, du fabuliste : animaux au naturel humanisés par leur posture et/ou leur gestuelle, leur action, leurs accessoires (fig. 3) ; animaux à demi métamorphosés (en posture et vêtements humains mais conservant leurs membres zoomorphes) ; animaux hybrides, peu nombreux, qui reprennent la formule des « métamorphoses » ; animaux en posture naturelle, mais dotés d’une tête humaine. Parallèlement, l’artiste abandonne le dessin linéaire et simplifié des Métamorphoses du Jour, colorié en aplats de couleurs franches et vives, et conçu pour faciliter au grand public le déchiffrement de l’image et la saisie immédiate de l’idée, pour une facture plus dense, plus raffinée et plus précise, servie par la gravure sur bois de bout, qui traduit son souci de conjuguer exactitude anatomique et poétique du trait. L’art de Grandville, nourri par la fréquentation du texte de La Fontaine, offre désormais une large gamme de nuances, formelles et stylistiques, pour exprimer la perméabilité du règne humain et du règne animal.
Un dispositif de classification sociale
|
Le succès de l’illustration des Fables marque une étape importante dans la carrière de Grandville, qui alimente ses ambitions, mais les deux dessins des Fables qu’il présente au salon en 1840 se voient refusés. Perdant alors tout espoir de carrière officielle dans les arts, il concentre désormais ses efforts sur son métier d’illustrateur dont il entend améliorer le statut, s’efforçant de passer de sa condition d’illustrateur-interprète à celle « d’artiste-créateur ». La réalisation des Scènes de la Vie privée et publique des Animaux, ouvrage publié en cent livraisons par Hetzel et Paulin (puis Hetzel seul) de 1840 à 1842, lui offre ce privilège.
Après la publication des Fables, Fournier n’envisageant pas de réaliser dans l’immédiat un autre ouvrage illustré, Grandville se tourne vers les éditeurs Hetzel et Paulin avec un nouveau projet. Il souhaite publier un album de dessins légendés, sans toutefois posséder les qualités littéraires requises pour cette entreprise. C’est probablement ce constat qui conduit Pierre-Jules Hetzel, alors au début de sa carrière, à concevoir une réalisation plus ambitieuse : il s’agit de brosser un vaste panorama critique de la société française sous le nouveau régime de Louis-Philippe, dans un ouvrage conçu prioritairement pour diffuser les dessins de l’artiste ; les quatorze auteurs sollicités par l’éditeur ne jouent que les seconds rôles : des journalistes aujourd’hui oubliés ; d’autres, plus célèbres, qui sont aussi des gens de lettres, comme Jules Janin, le « prince des critiques » au Journal des débats, ou Louis Viardot, directeur de théâtre, qui vient de fonder avec George Sand la Revue indépendante (1841). Hetzel rédige lui-même la préface, le prologue, ainsi que neuf chapitres qu’il signe du pseudonyme de P.-J. Stahl, utilisé pour la première fois dans son œuvre. On trouve aussi, parmi les auteurs des Scènes, des écrivains consacrés, comme Charles Nodier, George Sand, Paul et Alfred de Musset, et « de Balzac » qui se trouve parmi les premiers collaborateurs du projet : il donnera quatre textes sous son nom, le cinquième, le Voyage d’un moineau de Paris à la recherche du meilleur gouvernement, étant publié sous la signature de George Sand. Hetzel a besoin de la contribution de ces plumes célèbres pour assurer l’honorabilité de son entreprise : il s’agit de la distinguer des publications commerciales qui envahissent alors le marché, d’offrir un ouvrage « honorable et littéraire », afin ne pas prêter le flanc aux critiques qui dénoncent, en plein essor du livre illustré, le mercantilisme des marchands d’images.
L’ éditeur assure la cohérence de sa publication en établissant – en collaboration Grandville – une liste de trente-cinq animaux qu’il soumet aux écrivains pressentis en leur laissant toute liberté quant au choix du genre littéraire :
« On peut faire des drames, des comédies, des nouvelles, des discours, des essais, des méditations, des considérations, des confessions, des voyages, des lamentations, des rêves, des contes vrais ou fantastiques, des mémoires, des confidences, etc., etc. »
La conséquence est que l’ouvrage présente une gamme variée de genres littéraires : on y trouve l’Histoire d’un lièvre et l’Histoire d’un merle blanc ; le Voyage d’un moineau de Paris et le Voyage d’un lion d’Afrique ; les Aventures d’un papillon ; les Peines de cœur d’une chatte anglaise ; le Feuilleton de Pistolet ; les Mémoires d’un crocodile et les Souvenirs d’une vieille corneille ; les Lettres d’une hirondelle ; les Opinions philosophiques d’un pingouin ; les Doléances d’un vieux crapaud, et même l’Oraison funèbre d’un ver à soie.
À la diversité des auteurs, des inspirations, des styles, Grandville répond par la permanence et l’homogénéité de son protocole illustratif. En premier lieu, à la différence de ses illustrations de La Fontaine, il systématise l’emploi de la figure animale : tout l’univers s’animalise sous son crayon. D’autre part, il décline ses figures animales à travers deux catégories d’images, formes canoniques de l’illustration à l’époque romantique : les « scènes », qui réunissent des personnages engagés dans une action ; et les « types », issus de la caricature, qui résument les traits généraux et caractéristiques d’une catégorie sociale ou d’un caractère humain. Ce protocole a été fixé par contrat avec Hetzel : l’artiste s’est engagé à fournir pour chaque volume « cinquante grandes vignettes représentant des scènes de la vie privée et publique des animaux » et « cinquante autres vignettes représentant des types humains métamorphosés ».
Tous les « types » sont des humains animalisés ; comme dans les Métamorphoses du jour, leur fonction est de révéler la bête qui est en l'homme ; toutefois, Grandville leur ôte ici tout caractère narratif ou anecdotique au profit de l’idée générale : un seul personnage en pied occupe toute la page, représenté dans un décor domestique, urbain ou naturel, sommairement esquissé, formé d’objets et d’attributs qui contribuent à le caractériser. Dans la mesure où il tend à l’abstraction, le « type » n’a pas pour fonction de traduire littéralement le texte qu’il accompagne et n’est donc pas, à proprement parler, une illustration. Il s’appuie sur un personnage issu de la plume de l’écrivain, lui emprunte un trait saillant – ainsi le thé et la Bible de la vieille fille anglaise des Peines de cœur d’une chatte anglaise – mais il s’en éloigne volontiers : témoin, cette jeune miss jouant du piano, qu’il dote d’un faciès canin, d’une patte de chien et d’une main humaine (fig. 4).
|
Les « scènes », en revanche, donnent à voir des animaux occupés à des actions humaines, mais qui ont conservé leurs particularités zoomorphes (fig. 5). Elles soulignent l’humanité de la vie animale, invitant l’homme à imiter ses vertus, idée chère à Grandville. À l’inverse des « types », ce sont des illustrations, qui offrent une traduction plastique d’un épisode, suivant des modalités variables de collaboration avec les écrivains : certains auteurs consacrés (Musset, Nodier) livrent un texte achevé, que Grandville illustre – au sens traditionnel du terme ; d’autres, habitués à se plier aux exigences du journalisme, rédigent le leur en tenant compte des dessins et des indications de l’artiste : c’est le cas, par exemple, de Louis Viardot. C’est par le biais de ce protocole illustratif inédit que les images de Grandville s’affranchissent de la position seconde propre à l’illustration de cette époque. D’autre part, ces gravures, reproduites en hors-texte – un parti pris délibéré puisque le bois de bout permet de combiner texte et image sur la même page –, sont assimilées à des estampes, offrant en parallèle à la série des textes une suite d’images détachables. Cette autonomie de l’illustration, tout à la fois sémantique et matérielle, sert les revendications de l’artiste, qui voit là une occasion de « faire l’auteur » ; elle répond également au vœu d’Hetzel, soucieux d’échapper au qualificatif de « vendeur de croquis » qui, en ces années 1840 où le développement des livres « musées d’images » commence à susciter de vives critiques (8), menace tout éditeur de livres illustrés (9).
Du comique au fantastique
|
Le succès des Scènes conduit Grandville à concevoir un nouvel ouvrage dont il serait, cette fois, l’auteur et l’illustrateur : le contrat d’Un autre monde, signé avec l’éditeur Fournier en 1842, stipule que « le texte sera rédigé par un littérateur d’après ses notes » (10). Le propos, intellectuellement plus ambitieux que dans les ouvrages précédents, vise les goûts, les idées et les idéaux, les sciences et les arts de l’époque. Dans le chapitre intitulé « Un après-midi au jardin des plantes », qui entend ridiculiser les classifications et les querelles des zoologistes, on retrouve le principe d’hybridation mis en œuvre par Grandville en d’autres occasions, mais appliqué ici aux animaux eux-mêmes : monstres bicéphales, hybrides formés d’espèces incompatibles (oiseaux ruminants, quadrupèdes ailés, insectes pachydermes, etc.). L’effet fantastique prévaut désormais sur le comique (fig. 6). Ces images ne sont pas l’œuvre d’un « fou », comme l’ont pensé les contemporains de Grandville, ni le fruit d’un génie « visionnaire », précurseur du Surréalisme, comme le croiront naïvement Georges Bataille et Pierre Mac Orlan (11) ; elles sont le fruit de la déclinaison systématique d’une combinatoire, héritière d’un artisanat ancestral de la monstruosité étudié par Gilbert Lascaux (12), dont, à la vérité, la recette se rencontre déjà chez Léonard de Vinci : « Si tu veux donner apparence naturelle à une bête imaginaire, supposons un dragon, prends la tête du mâtin ou du braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson, le museau du lièvre, le sourcil du lion, les tempes d’un vieux coq et le cou de la tortue ». Grandville conjugue, imbrique, assemble méthodiquement les parties, « rarrange » la création, selon le mot ironique de Baudelaire : « Je n’invente pas, précise-t-il, je ne fais qu’associer des éléments disparates et enter les uns sur les autres des éléments antipathiques ou hétérogènes ». Le fantastique qui naît de ce bricolage n’est pas pour lui une fin en soi, mais un outil satirique : l’étrange, l’absurde, le monstrueux doivent provoquer chez le spectateur un sentiment de malaise qui déclenche sa réflexion : « Où finit l’animal, ou commence l’humanité ? »
Depuis ses premiers dessins jusqu’à ses derniers ouvrages, Grandville a développé une même vision satirique et critique des hommes et de la société de son temps, fondée sur un dispositif graphique de métissage des espèces animale et humaine propre à susciter, dans une optique moraliste, une réflexion sur leur communauté de nature. L’examen des métamorphoses successives de ces « métamorphoses » met en lumière l’incidence des projets et des supports éditoriaux sur les variations du modèle initial : chacun de ces supports – album, livre illustré, « musée d’images » –, par ses caractéristiques matérielles, formelles et techniques, son concept, son statut culturel et artistique, ses destinataires, a autorisé, favorisé ou engendré telle ou telle facette – comique, satirique, philosophique ou fantastique – de la création animalière de Grandville.
Contribution à L’Œil écrit. Études sur les rapports entre texte et image, 1800-1940. Volume en l’honneur de Barbara Wright, édité par Derval Conroy et Johnnie Gratton, Genève, Slatkine Érudition, 2005.
___
1 - Le Quintet à vent, dessin à l’aquarelle et à la plume, 14,7 x 20,5 cm, Bibliothèque municipale de Nancy.
2 - Voir notamment le papyrus n° 55001 du musée de Turin, 1186-1070 avant J.-C.
3 - Charles Baudelaire, « Quelques caricaturistes français », Le Présent, 1 er octobre 1857.
4 - Voir le catalogue d'exposition sur les Métamorphoses du jour, édité à l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’artiste, Musée des Beaux Arts de Nancy, 2003.
5 - Honoré de Balzac, Voyage d’un lion d’Afrique à Paris , dans Scènes de la vie privée et publique des animaux., Paris, Hetzel et Paulin, novembre 1841, livraisons 46-48.
6 - Voir, par exemple, les lithographies des Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne France, sous la direction du Baron Taylor, 1820-1878.
7 - Fables de La Fontaine illustrées par J.J. Grandville, Paris, H. Fournier aîné et Perrotin, 1837, 2 vol. et H. Fournier, 1840, 1 vol.
8 - Voir F. de Lagevenais, « La littérature illustrée », Revue des Deux-Mondes, 15-2-1843, p. 645-671.
9 - Elias Regnault, « L’Éditeur », Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Lécrivain et Toubon, 1860 (première édition en 1839-1840 chez Curtmer), p. 393.
10 - Un autre monde, Transformations, visions, incarnations […] lithomorphoses, métempsychoses, apothéoses et autres choses, par Grandville, Paris, H. Fournier, 1844.
11 - Georges Bataille, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1970, vol. 1, p. 187-189. Voir Annie Renonciat, « La Barque à Caron. Fortune critique des effets comiques chez Grandville », numéro spécial d’Humoresques sur « L’Image humoristique », sous la direction de Thierry Chabanne, n° 3, Z’éditions, 1990, pp. 21-35.
12 - Gilbert Lascault, Le Monstre dans l’art occidental : un problème esthétique, Paris, Klinsieck, 1973.